De Monteverdi à Cardew, de Sweelinck à Zinsstag, de Marenzio à Letort, nous expérimentons la richesse et la diversité des compositeurs de la Renaissance et d'aujourd'hui.

Voici dix années que l’Ensemble Tarentule tisse patiemment sa toile, discrètement, loin des tumultes du monde. Dix années à peaufiner notre style, à polir notre vocabulaire, à ciseler les motifs de nos madrigaux, à aiguiser le mordant de nos fulgurances. Avec une pugnacité sans faille, telle la tortue de la fable, nous avançons inexorablement, la foi du charbonnier chevillée aux cordes vocales.
10 ans, le bel âge, l’âge de déraison, dix ans que nous œuvrons sans tambour ni trompettes. Mais nous sommes maintenant fin prêt à ouvrir le rideau. Comme avant une grande célébration, nous mettons les dernières touches pour que la fête soit parfaite, pour accueillir tous ceux qui voudront bien se donner la peine d’entrer.
Et pour cette occasion unique, nous avons convié tous nos compagnons de route, les plus fidèles, pas toujours les plus connus, mais certainement les meilleurs d’entre tous ; Giaches de Wert, Luca Marenzio, Claudio Monteverdi, Jan Pieter Sweelinck, Carlo Gesualdo et Adriano Banchieri .
Télécharger le PDF
Tarentule se propose ici d’interpréter les répons du samedi saint, ultime partie des répons de Gesualdo, composés de ceux du jeudi et du vendredi saint. Cet ouvrage impressionnant, tant par sa taille que par son ampleur artistique, marque à la fois l’apogée artistique de son auteur, et la fin d’un monde : celui de la polyphonie de la Renaissance, en train d’être remplacée par l’esthétique Baroque qui séduit l’Europe toute entière.
L’œuvre de Carlo Gesualdo est, par bien des aspects, à la fois sépulcrale - tant par son sujet que par sa position d’ultime chef d’œuvre de la Renaissance déjà achevée - et séminale - quant à ses prolongements et son esthétique -. En effet, sa composition (œuvre d’un compositeur qui n’écrit que pour lui-même sans nécessité, ni commande, et qui n’aura peut-être jamais été vraiment jouée durant un office, sinon pour son auteur lui-même) et la nature même de sa matière musicale, chromatique, polymodale, ne trouveront d’équivalent que des siècles plus tard. C’est donc un ouvrage à la fois archaïque pour son époque, et en avance sur son temps.
Télécharger le PDF

Le présent programme regroupe plusieurs œuvres a cappella de musique sacrée pour quatre voix mixtes. Il s’agit de parcourir les esthétiques des XVIème et XXIème siècles, de confronter, à cinq cents ans d’intervalle, leurs discours musicaux, de donner à percevoir les différences mais aussi les invariants, quand il s’agit pour un compositeur de traduire, en polyphonie, la spiritualité chrétienne.
Autour du remarquable travail polyphonique de Roland de Lassus (1532-1594), Tarentule propose de faire découvrir deux compositeurs d’aujourd’hui avec lesquels il aime travailler sur les programmes en miroir : Nicolas Bacri et Stéphane Orlando.
L’approche de cette musique a ouvert à Tarentule de nouvelles voies d’interprétation et d’exploration de l’outil vocal tant au niveau de l’expressivité que des textures. Les voix, formées à la polyphonie de la Renaissance, élaborent une grammaire nouvelle. L’auditeur n’écoute plus sentencieusement ces madrigaux du XXIème siècle, parfois un peu distants, mais au contraire se laissent porter par eux et emplis de leur souffle vivifiant.
Télécharger le PDF
Cornelius Cardew est et reste un personnage central dans le renouveau des questionnements sur l’interprétation musicale durant la seconde moitié du XXème siècle, avec Cage, Feldman et Stockhausen. La radicalité de son approche va le mener à réaliser son ouvrage définitif sur la question, le fameux « Treatise », ensemble de près de 200 partitions graphiques composées de 1963 à 1967.
Le propos de Cardew était de proposer une écriture musicale sans nomenclature définie à l’avance et qui devait faire l’objet d’un consensus entre tous les musiciens avant l’exécution de l’œuvre. Le second aspect de cette nouvelle approche était que cette écriture devait permettre aux non-musiciens de se saisir de la partition et de proposer des interprétations sans avoir besoin, au préalable, d’une quelconque formation musicale savante. Cet aspect de la philosophie musicale de Cardew est dans une large mesure un échec car seuls des musiciens chevronnés se sont, à ma connaissance, jusqu’alors risqués à proposer une interprétation des ses œuvres.
L’approche de cette musique a ouvert à l’Ensemble Tarentule de nouvelles voies d’interprétations et d’explorations de l’outil vocal, tant au niveau de l’expressivité que des textures (ex. : la voix bruitiste). La réaction du public est étonnante car, loin de considérer ce jeu comme un exercice de style de pure forme, un peu vain, il y perçoit une façon nouvelle d’envisager le matériau et l’interprétation musicale et vocale.
En voyageant à travers les partitions graphiques de Cornélius Cardew, nous avons voulu rapprocher entre elles plusieurs œuvres issues de plusieurs époques pour les éclairer d’une lumière nouvelle. Les voix, formées à la polyphonie, élaborent une grammaire nouvelle, accompagnées par l’accordéon de Pascal Contet, devenant voix à son tour, puis orgue ou clavecin dans les œuvres de Couperin ou Bach. Et les musiques des Grands Maîtres de la Renaissance que sont Sweelinck, de Wert, Marenzio ou Gesualdo se parent de nouvelles couleurs au contact des compositeurs baroques, eux-mêmes travaillés de l’intérieur par la musique contemporaine (Purcell/Sandström) et des mélopées hypnotiques de Philip Glass.
Un dénominateur commun : l’air, l’atmosphère ; aller chercher dans toutes ces œuvres une sensation qui fait le lien, une sensation d’apesanteur, de légèreté pour autoriser l’auditeur à ne plus écouter sentencieusement ces beaux objets, parfois un peu distants, mais au contraire se laisser porter par eux et se laisser emplir de leur souffle vivifiant.
Télécharger le PDF
Dans l’histoire musicale la place que tient Carlo Gesualdo est très particulière, de par son rang, de par son style et de par sa personnalité, tous indissociablement liés.
Car si l’on doit à Gesualdo ces fulgurances, ces audaces et cet affranchissement des règles en vigueur dans la composition contrapuntique de l’époque, c’est sans doute le fait de tous ces éléments. En tant que prince de Venosa et Comte de Conza, Gesualdo n’a de compte à rendre qu’à lui-même, indépendant de tout employeur ou mécène pouvant lui imposer ses commandes et le borner dans ses ambitions artistiques. Cette position rarissime à l’époque pour les musiciens de cour, ainsi que sa personnalité tourmentée, son histoire dramatique et monstrueuse, et sa fin aux confins de la folie et du mysticisme, achèvent de donner à l’œuvre de Gesualdo une place hors du commun dans le paysage musical de l’époque.
Télécharger le PDF
Le présent programme se propose de faire découvrir à l’auditeur le long et passionnant parcours des plus grands compositeurs, souvent méconnus, de l’École d’orgue du Nord, initiée par Jan Pieterszoon Sweelinck et qui culminera un siècle plus tard avec Johannes Sebastian Bach. Cette proposition se déclinera en deux parties distinctes : la première consacrée aux compositeurs de la fin du XVIème siècle et du début du XVIIème siècle, et la seconde dévolue aux compositeurs de la fin du XVIIème siècle et du début du XVIIIème siècle.
Le nom de Johannes Sebastian Bach culmine au firmament des compositeurs les plus connus et les plus adulés à travers le monde. Mais, comme souvent, la constitution de la figure du grand homme dans la culture populaire s’accompagne de l’effacement de sa filiation esthétique pour mieux mythifier l’histoire d’un surgissement spontané issu de la seule personnalité « hors norme ». Cette histoire qu’on se raconte provient surtout de la philosophie du XVIIIème siècle qui « invente » l’individu et cherche à consolider cette idée révolutionnaire par l’exemple de personnage pouvant l’incarner et la légitimer : le génie.
Mais c’est perdre beaucoup de la richesse et de la complexité tant artistique, esthétique qu’historique que de vouloir séparer ainsi l’homme (car il ne s’agit étrangement toujours que d’hommes…) de son époque, de sa formation, de ses contemporains, avec qui il entretient de nombreux rapports et échanges, mais aussi de ses prédécesseurs qui ont œuvré avant lui pour qu’il puisse devenir le compositeur que nous connaissons.
Télécharger le PDF
Depuis bientôt quatre ans, l’Ensemble Tarentule élargit son répertoire à la polyphonie du XXIème siècle. Différents compositeurs, inspirés par l’écriture madrigalesque de la fin de la Renaissance, ont eu envie de création a cappella pour quatre, cinq, six ou sept voix.
Chaque année Tarentule offre ainsi au public une ou plusieurs œuvres inédites – le plus souvent en concert miroir avec des madrigaux de la fin de la Renaissance.
L’approche de cette musique a ouvert à Tarentule de nouvelles voies d’interprétation et d’exploration de l’outil vocal tant au niveau de l’expressivité que des textures. Les voix, formées à la polyphonie de la Renaissance, élaborent une grammaire nouvelle. L’auditeur n’écoute plus sentencieusement ces madrigaux du XXIème siècle, parfois un peu distants, mais au contraire se laisse porter par eux et emplis de leur souffle vivifiant.
Le présent programme - construit autour de pièces profanes et sacrées écrites ou spécialement adaptées pour l’Ensemble Tarentule par six compositeurs de ce siècle – en est une illustration.
Télécharger le PDF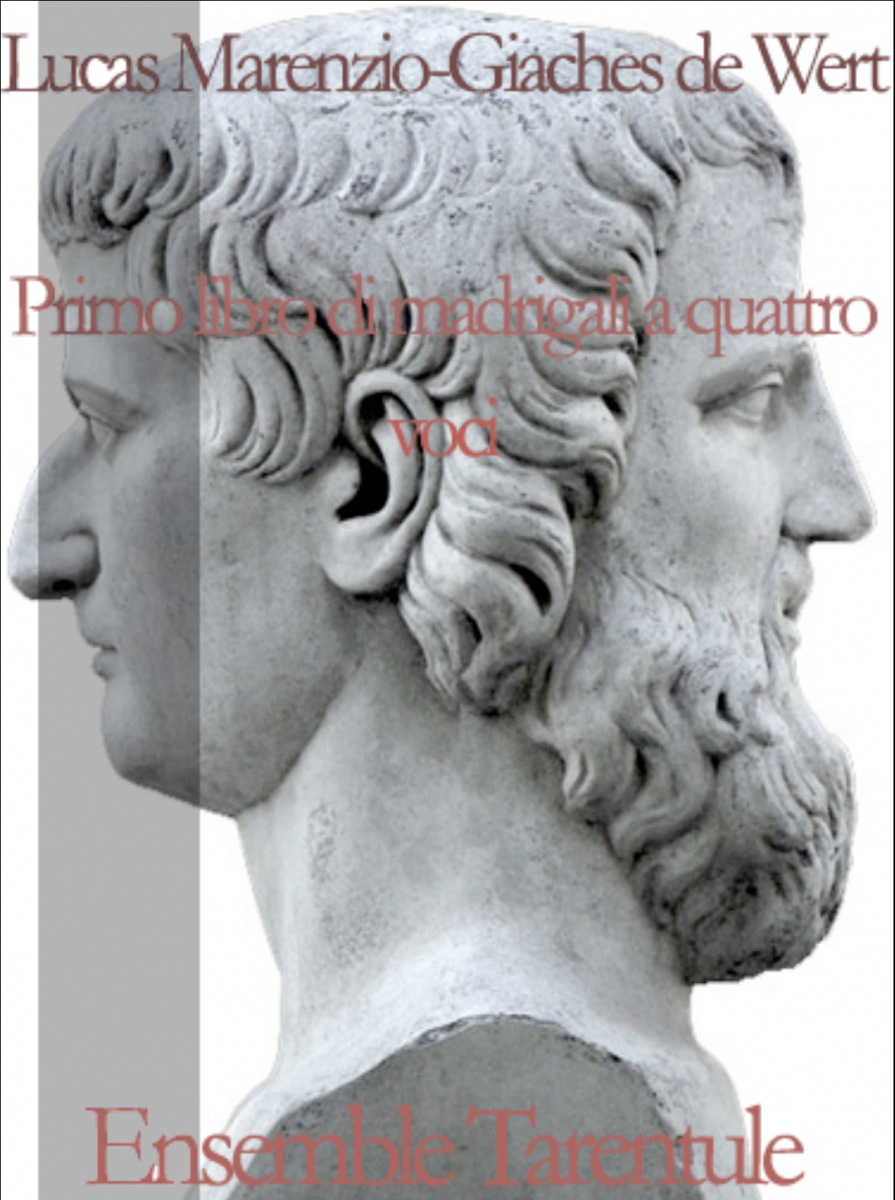
Giaches de Wert (1535-1596) et Lucas Marenzio (1553-1599), deux des plus
grands compositeurs de polyphonie vocale de la fin du XVIème siècle, sont aussi deux
des moins connus. Face à Monteverdi, Lassus et Gesualdo, il n’est pas rare que
l’évocation de leurs noms ne provoque au mieux qu’un froncement de sourcils. Nous
voudrions par le présent programme réparer cette injustice et donner à entendre la
magnificence et le génie de ces deux compositeurs d’exception, éclipsés dans l’histoire
musicale par une profusion de talents comme peu d’époques ont connu...

Le présent programme se propose d’explorer la dimension ludique de la musique vocale a cappella, du XVIème et du XXIème siècle.
En soit la musique fait déjà intervenir la notion de jeu au sens large, mais il est certains répertoires où cette notion est encore plus performative, comme par exemple celui de la chanson bruitiste du XVIème siècle dont Clément Janequin s’est fait une spécialité et une gloire. En substituant aux mots et aux phrases des sons onomatopéiques, Janequin à littéralement inventer un genre, celui de la chanson polyphonique imitative. En ouvrant cette exploration, il fait preuve d’une inventivité et d’une espièglerie sans pareille, du Chant des oyseaux aux Cris de Paris, en passant par le grondement de la Guerre et les trépidations de la Chasse.
Pour accompagner Janequin et ses cabrioles vocales, nous avons adjoint à ce programme d’autres façons d’envisager la ludicité vocale et musicale :
- en premier lieu, l’interprétation de trois partitions graphiques de Cornelius Cardew, proche de Cage, qui, dans les années soixante, a proposé de repenser la nomenclature musicale pour en faire un lieu d’interrogation et d’interprétation collectif, comme un jeu de société dont les règles doivent être repensées à chaque nouvelle partie.
- ensuite, pour continuer notre marelle, nous convoquons Roland de Lassus, avec quelques chansons qui se jouent des convenances du temps (religion et institution matrimoniale).
- enfin nous invoquons ici deux compositeurs vivants : Denis Bosse, avec une œuvre en forme de jeux rythmiques, et Guy Reibel, grand spécialiste des jeux vocaux.
Un programme polyphonique/humoristique.
Télécharger le PDF
Le présent programme se propose d’explorer la thématique du rapport entre la préscience et la folie exprimées dans ce corpus très particulier que sont les "Prophétie des Sibylles" de Roland de Lassus.
Cet ensemble de treize pièces homogènes de Roland de Lassus constitue une étonnante tentative de faire se rejoindre l’art divinatoire des polythéismes classiques et la tradition prophétique présente dans les monothéismes. Sur cet argument très usité à l’époque d’une certaine forme de prescience presque inconsciente des anciens classiques pour la venue du Christ, Roland de Lassus a composé un ensemble de 13 pièces polyphoniques teintées d’un chromatisme stupéfiant devant traduire tout à la fois l’exotisme, le mystère et le mysticisme à l’oeuvre dans ces prophéties...
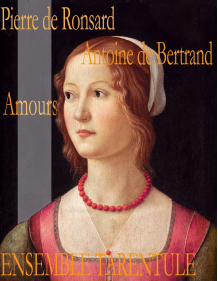
Si la musique profane, à la Renaissance, s’est constituée autour de la mise en musique de la Poésie du temps, rares sont les compositeurs qui auront poussé aussi loin l’identification de leur musique à l’esthétique d’un seul et unique poète.
C’est le cas exceptionnel d’Antoine de Bertrand (1540-1580) qui mettra en musique la grande majorité du cycle des Amours de Ronsard. Il poussera même la similitude jusqu’à dédicacer chacun de ses recueils au nom d’une femme aimée tout comme l’illustre poète dont il s’inspire.
Le présent programme a pour but de mettre en lumière l’art exceptionnel d’Antoine de Bertrand pour magnifier la poésie déjà sublime de Pierre de Ronsard. Dans ce concert déambulatoire, la poésie rendue polyphonique sera confrontée au texte déclamé permettant ainsi à l’auditeur tout à la fois de goûter la pureté du texte et sa subtilité, puis d’éprouver comment le compositeur amplifie le texte par la science de ses harmonies.
Télécharger le PDF
L’Ensemble Tarentule propose d’interpréter à cinq voix, et a cappella, deux chef-d’œuvres de la fin de la Renaissance.
L’œuvre - Voyage initiatique Barca di Venetia per Padova (La barque de Venise à Padoue) est un assemblage de madrigaux qui se déroulent au cours d’un trajet en barque, de Venise à Padoue. Vingt saynètes dans lesquelles se rencontrent des personnages inspirés pour certains de la commedia dell’arte (marchands juifs ou l’allemand Vaine) et pour d’autres du quotidien des congénères vénitiens de Banchieri (pêcheurs, courtisanes ou bien encore avocats de Murano) ... aux attitudes et motivations aussi diverses que variées. Les liens se resserrent au cours du trajet.
Toujours autour de cette traversée sur l’eau, le célèbre « Lamento d’Arianna » est le seul témoignage de l’opéra de Monteverdi L’Arianna, irrémédiablement perdu dans l’incendie de la bibliothèque ducale de Mantoue en 1630.
Il s’agit de la pièce centrale de cet opéra qui voit Ariane abandonnée par Thésée sur une île après que celle-ci l’ait aidé à vaincre le labyrinthe et à s’enfuir de Crète.
Télécharger le PDF